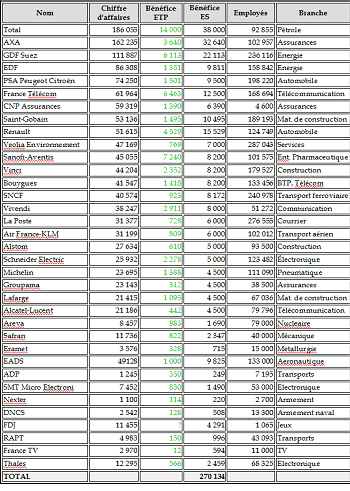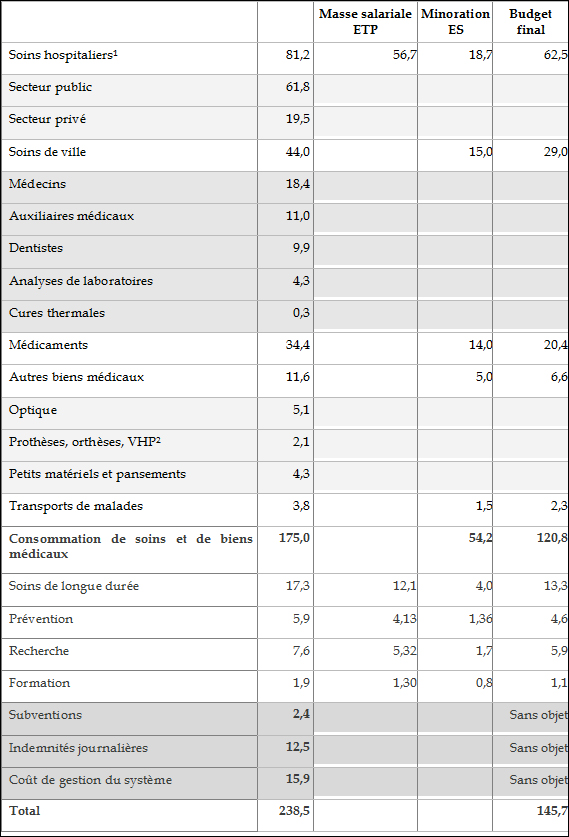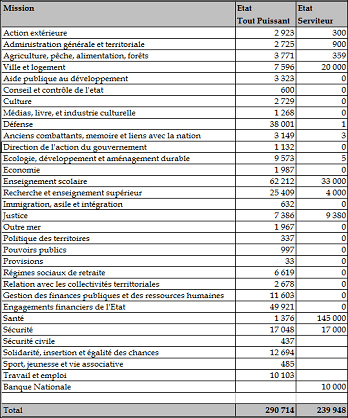Support de débat pour la réunion du 29/12/2022 à 14h00 sur https://meet.jit.si/decroissance
Critique objective de la croissance, par Christian Laurut – Chronique n°15 – Rubrique : L’impasse alimentaire – Sujet : La troisième transition alimentaire
Dans les chroniques précédentes, consacrées à l’impasse sanitaire, nous avons rappelé que la santé était classée au deuxième rang des besoins fondamentaux de l’homme, tout juste derrière les besoins dits organiques que sont la respiration, le sommeil et… l’alimentation (boisson comprise bien évidemment). C’est donc bien d’alimentation humaine que nous allons parler maintenant, en tant que besoin essentiel et premier de l’homme. Qu’il soit homo erectus, devenu homo sapiens ou désormais homo industrialis, rien n’y fait et rien n’y change, l’alimentation reste bien toujours son besoin premier et, accessoirement, facteur irrémédiablement létal en cas de carence prolongée.
Cette dépendance incontournable de l’homme vis à vis de l’alimentation, et plus fondamentalement vis à vis de l’eau, s’oppose notamment à l’incommensurable orgueil de certains thuriféraires de la société industrielle croissanciste qui pensent que l’homme est devenu plus puissant que la Nature et même que sa propre nature.
Ce péché d’orgueil les amène à se heurter de front à cette limite bio-naturelle infranchissable, à devoir tempérer quelque peu, pour l’instant, leur rêve fou d’homme augmenté ou trans-humain qui, à l’issue de manipulations génétiques de plus en plus avancées, pourrait, pourquoi pas, viser à s’exonérer de cette contrainte triviale.
Mais ce rêve d’un homme libéré de la contrainte alimentaire que caressent certains esprits sur-scientifiques ne fait pas l’affaire de tous les promoteurs de la société de la croissance, dont la majorité, bien entendu, voient plutôt dans cette contingence, la possibilité d’une source inépuisable de profits.
Car avant d’être une activité marchande, presque comme les autres, l’alimentation a été d’abord une activité naturelle, au sens écologique du terme, c’est à dire liée aux lieux et conditions d’existences des êtres vivants et aux rapport qu’ils établissent avec leur environnement.
Cette première considération nous amène à deux hypothèses préalables, exposées d’ailleurs en forme d’évidences.
- La première c’est que l’homme, du point de vue de son besoin d’alimentation, n’est qu’un animal comme un autre.
- La seconde c’est que l’acte alimentaire constitue un rapport à l’environnement, et sans aucun doute le rapport le plus fondamental qui, par ailleurs et rappelons-le, a été longtemps le seul rapport que l’homme ait entretenu avec son environnement, avec la Nature, avec sa mère nature.
Cette fonction alimentaire exclusivement naturo-centrée, de type chasseur pêcheur cueilleur, s’est d’ailleurs exercée pendant une très longue période, puisque, même si nous nous nous limitons à l’homme en tant qu’homo sapiens, ce mode alimentaire a perduré environ 300.000 ans.
Nous rappellerons également que cette période de 300.000 ans pourrait être allongée à 2 ou 3 millions d’années pour peu que nous convenions d’étudier le fait alimentaire de genre homo dans son ensemble.
Et Ce n’est que depuis 10.000 ans à peine (date de la révolution néolithique), qu’homo sapiens a commencé non plus entretenir, mais à établir, de nouveaux types de rapports avec son environnement autres que ceux relevant du seul geste de prédation alimentaire.
Ceci étant posé, il paraît intéressant de rapprocher, ou plutôt d’inclure, le besoin alimentaire au sein du besoin plus global de sécurité, dans lequel s’inscrit également la santé que nous avons étudié lors des chroniques précédentes.
Le facteur sécurité, associé au facteur alimentation, c’est dire la notion de « sécurité alimentaire », constitue évidemment un objectif central de la trajectoire humaine depuis son aube, mais l’histoire (je dis bien l’histoire, pas la préhistoire, c’est à dire la relation des faits humains par des sources écrites soit depuis environ -4,000 av JC seulement) nous montre bien que cet objectif n’ a jamais été atteint en dépit des multiples soi-disans avancées civilisationnelles diverses et variées.
sauf depuis disons 70 ans, date depuis laquelle cette fameuse « sécurité alimentaire » prétend avoir été acquise, durablement acquise, notamment dans les pays dits développés, c’est à dire chez les champions de la croissance, au point qu’elle ne semble plus jamais devoir y être remise en question.
Encore un axiome de plus édicté par la société croissanciste : la « sécurité alimentaire durable » que nous allons devoir démythifier comme nous l’avons notamment déjà fait pour le PIB, ou la médecine médicamenteuse.
Cette quasi-loi de la sécurité alimentaire, dont nous devons préciser en préambule qu’elle présente deux aspects complémentaires, mais néanmoins distincts : un aspect qualitatif et un aspect quantitatif (nous y reviendrons), a donc été promulguée depuis finalement très peu de temps.
Sa mise en place, après la fin de la seconde guerre mondiale, que nous dénommerons « troisième transition agro-alimentaire », a été précédée de deux autres transitions :
la première c’était il y a environ 10.000 ans avec la sédentarisation de l’homo sapiens parallèlement à l’abandon progressif du mode alimentaire chasseur pêcheur cueilleur et aux débuts de la domestication par l’homme de la nature végétale, (cad l’agriculture) et de la nature animale (cad l’élevage).
La deuxième (transition agro-alimentaire) se situe aux environs de l’année 1850, date conventionnelle de début de la société industrielle, à partir de laquelle de nouvelles méthodes issues des avancées technologiques de l’industrie furent appliquées, surtout à l’agriculture et pas trop encore à l’élevage.
Cette deuxième transition fut caractérisée par le début de la mécanisation qui facilita le travail nécessaire aux différentes opérations du process agricole, ainsi que par le commencement de l’emploi des engrais chimiques qui contribua à augmenter le volume des récoltes.
Cette deuxième étape importante dans l’évolution du mode de production de nos aliments révèle 2 faits majeurs plus ou moins interactifs entre eux :
Le premier fait est celui que nous nommerons le « point de non-retour » :
A partir de cette date, en effet, nous pouvons affirmer sans exagération que l’homme coupe définitivement les ponts avec sa mère nourricière, la nature, pour ne faire dépendre son alimentation « que » de la technologie issue de son cerveau. En effet, avant cette date, l’évolution des choses avait été somme toute relativement minime et un retour en arrière au mode alimentaire originel, bien que compliqué sans doute, n’aurait pas semblé toutefois totalement impossible.
En effet, si nous nous reportons à nos fameuses trois courbes fondamentales : évolution de la prédation des ressources naturelles finies, évolution de la production de biens (dont, bien évidemment les produits alimentaires) et évolution de la démographie, nous pouvons constater qu’elles présentent toutes trois un sinus (par rapport à l’axe horizontal du temps) assez faible jusqu’en 1850, date à partir de laquelle elles se cabrent brusquement de façon asymptotique.
Et la première conséquence de cet emballement des indices, c’est naturellement le dépassement de la biocapacité naturelle alimentaire, c’est à dire le niveau moyen de production alimentaire naturelle d’un hectare global, concrétisé par la donnée objective que la quantité de population mondiale était désormais devenue trop importante pour être nourrie avec un système d’alimentation naturel.
De ce point de vue, également, nous pouvons dire qu’à partir de cette date, l’homme a définitivement quitté le monde animal, et que cette rupture alimentaire est certainement la distinction la plus factuelle qui existe maintenant entre les deux espèces.
Le deuxième fait est l’introduction de données d’économie politique dans le processus de l’alimentation humaine, à savoir la notion de « rendement » et la notion de « productivité ». Notions complémentaires qui sont souvent confondues, mais qu’il convient, en réalité, de bien distinguer, car cette distinction entre ces deux notions va revêtir toute son importance pour la suite de notre propos.
Au niveau de leur définition stricte, nous dirons qu’en agriculture, la notion de rendement représente la mise en œuvre d’actions visant à augmenter le volume de la récolte, ou plus globalement de la production si nous incluons les produits animaux issus de l’élevage,
alors que la productivité est un indice représentant la quantité d’énergie totale (énergie mécanique, énergie humaine, et… même énergie grise au sens où nous l’avons définie dans la chronique sur l’impasse physique, c’est à dire la prise en compte de l’intégralité de toutes les consommations d’énergie intermédiaires, induites mais non visibles, nécessaires à l’élaboration d’un produit), quantité d’énergie totale, donc, nécessaire à l’obtention d’une unité moyenne de production.
La confusion entre ces deux indicateurs vient en partie du fait que le terme de « productivité » possède en racine celui de « production », alors que la mesure nette de la production est en réalité celle du rendement et que la mesure de la productivité est, en réalité, celle des moyens mis en œuvre pour obtenir ce rendement.
Sur le fond il est important de bien distinguer ces deux notions car, bien qu’elles paraissent indissociablement liées dans le cas d’une agriculture industrielle en plein essor, l’augmentation de la productivité venant alors s’associer à l’augmentation des rendements pour constituer, par cumul de ces deux facteurs, ce que nous avons appris à nommer la rentabilité, c’est à dire, nous y voilà, l’obtention du profit maximum pour les différents opérateurs économiques la filière.
Mais ces deux facteurs pourraient par contre se disjoindre, voire se contrecarrer, dans le cas d’une autre agriculture, une agriculture dont le modèle viendrait à tourner à vide, une agriculture industrielle au bout du rouleau, se rendant compte qu’elle est engagée dans une impasse (!) et que, en dépit de ses gains de productivité, c’est à dire en dépit du fait que les opérateurs utiliseraient toujours moins d’énergie dans la mise en oeuvre du processus de production, les rendements viendraient quand même à plafonner, provoquant du coup et par simple équation algébrique une baisse de cette même sacro-sainte productivité,
ou encore, dans le cas où l’augmentation du coût de l’énergie, ou de sa raréfaction, ou des deux cumulés, contribueraient à abaisser la productivité par un simple jeu d’écriture sans pour autant influer sur des rendements devenus irrémédiablement décroissants, le tout tirant naturellement la rentabilité vers le bas, voire tout simplement vers le fond.
Cette deuxième transition agro-alimentaire qui a accompagné les débuts de la société industrielle (vers 1850) a donc posé les fondements de l’agriculture moderne, mais son accélération vertigineuse ne date que de la fin de la deuxième guerre mondiale (après 1945), accompagnée, cette fois, de facteurs nouveaux liées à la stratégie géopolitique du capitalisme, en voie de mutation d’ailleurs vers un capitalisme mondial, mutation qui aboutira au concept flottant et équivoque, mais néanmoins largement vulgarisé de mondialisation.
En réalité, cette mondialisation de la production alimentaire, ce n’est ni plus ni moins que l’application par tous les agriculteurs de la planète d’un cahier des charges établi par le capitalisme croissanciste.
Mais à la différence de ce qui s’est passé dans le secteur secondaire, où l’artisanat a disparu sous les coups de boutoir de l’industrie, de nouveaux entrepreneurs prenant la place des anciens en les paupérisant ou, plus généralement, en les asservissants en tant qu’esclaves dociles par le salariat, le secteur primaire, l’agriculture, lui, a connu une évolution sensiblement différente, due à la spécificité de ce secteur, largement imprégné par le principe de la propriété foncière individuelle.
De plus, il ne s’agissait pas, en la matière, de créer artificiellement un secteur, de toutes pièces, entièrement basé sur un nouveau concept de prédation illimitée des ressources naturelles finies et d’utilisation de la science, mais, au contraire, de transformer un secteur pré-existant, avec sa sociologie propre, afin qu’il intègre dans son modus operandi la prédation illimitée des ressources naturelles finies et l’utilisation de la science.
C’est ainsi que les agriculteurs se transformèrent progressivement, plus ou moins consciemment, et plus ou moins à leur corps défendant, en chefs d’entreprise capitalistes, ce qui eut pour effet notamment de réduire considérablement leur nombre, puisque la mire de la rentabilité, premier stigmate de la capitalisation de l’agriculture, rendait inévitable la course à l’accroissement de la taille des exploitations.
Tout le monde connaît la statistique française : 80% d’agriculteurs en 1800, 5% d’agriculteurs en 2020. Ces chiffres se passent naturellement de tout commentaire.
Toute la question est alors de savoir, ou de comprendre, la façon dont cette mutation s’est opérée et quels en ont été les moteurs et outils essentiels. Autrement dit, les agriculteurs ont-ils volontairement opté pour le mode d’exploitation industriels, ou y ont-il été forcés, ou y ont-ils été seulement incités ?
Afin d’analyser cette question il convient au préalable de rappeler le contexte mondial ambiant de la fin de la deuxième guerre mondiale et à partir de l’année 1945.
La planète est alors dominée par deux superpuissances, vainqueurs militaires : les Etats unis et l’Union soviétique qui se partagent le monde à la conférence Yalta en répartissant leur influence entre deux blocs hermétiquement clos et avec l’accord tacite de ne pas influencer la politique d’un bloc sur l’autre.
Chaque superpuissance avait donc les mains libres pour imposer, de façon plus ou moins coercitive, son système économique au sein de sa sphère d’influence respective, chacune devant être protégée militairement par un pacte de solidarité, l’OTAN d’un côté, le pacte de Varsovie de l’autre.
Dans le monde occidental, sécurisé militairement dès 1949 par l’OTAN, dont le bouclier nucléaire et les forces armées émanaient principalement des Etats Unis, et sécurisé financièrement par les subsides du plan Marshall, émanant également des Etats Unis, le modèle américain allait tout naturellement s’imposer sans résistance aucune, et nous pouvons même dire dans l’enthousiasme général.
A partir de cette date fatidique, le domaine de la production agricole allait donc s’industrialiser encore plus rapidement que l’artisanat ne l’avait été avant lui.
La motivation majeure invoquée par les différents pouvoirs publics était de mettre fin définitivement aux risques de famines et d’accéder à l’autosuffisance alimentaire, mais ce magnifique et spectaculaire élan avait surtout pour objectif d’abaisser la part du coût de la nourriture dans le budget des ménages afin de libérer d’autant la part disponible pour pouvoir acheter tous les autres produits de consommation proposés par la société industrielle.
Dans cette période foisonnante de la reconstruction d’après-guerre et de démarrage des trente glorieuses, rien ne devait freiner l’essor de la consommation, et surtout pas la vulgaire contrainte alimentaire qu’il fallait, coûte que coûte, réduire au minimum.
Car la consommation alimentaire n’était pas jugée suffisamment extensible pour nourrir (si l’on peut dire!) la croissance globale, dont l’essentiel dépendait de l’accroissement de la consommation des produits de l’industrie et, surtout, des innombrables services naissants.
De ce point de vue, qui reste encore toujours vrai aujourd’hui, il est bien évident que la consommation alimentaire ne peut être sensiblement développée que grâce à un accroissement démographique, ce qui présente, de fait, une certaine limite,
mais surtout, il est également bien évident qu’à population constante, la production agricole ne peut être développée, non plus au delà d’une certaine limite, une fois les besoins essentiels comblés.
Double limite donc, qui n’existe pas, ou tout au moins qui peut être repoussée très loin pour ce qui concerne les autres produits, dont l’extensibilité de la consommation n’a de limite, cette fois, que le budget financier disponible par consommateur.
Pour les gestionnaires capitalistes, et par l’intermédiaire des gouvernements complices qu’ils contrôlaient et qu’ils contrôlent toujours aujourd’hui naturellement, il était donc fondamental, de faire en sorte que les produits alimentaires soient le moins cher possible, et ceci, afin que les consommateurs puissent disposer du maximum de leur revenus pour acheter tous les autres produits.
Posé ainsi, le montage présentait toutefois un point faible. En effet, si les denrées alimentaires devaient être abondantes et bon marché pour les raisons que nous avons indiquées, comment assurer une rentabilité à ceux qui allaient avoir la charge de les produire ?
Cette équation fut alors supposée devoir être résolue par le paramètre « augmentation des rendements » intimement associé à celui d’ « augmentation de la productivité », deux paramètres déjà cités.
Et c’est donc ainsi qu’il été décidé, à l’échelle de plusieurs continents, d’appliquer à l’agriculture le système d’exploitation industrielle, en ne craignant pas d’imposer, si nécessaire, par la force de la loi la métamorphose de toute une profession ainsi que l’abandon d’une logique professionnelle pourtant historiquement validée.
En effet, cette révolution ne peut pas être comparée à l’essor de l’industrie, qui, elle, a contrario, a été portée par le libéralisme et l’esprit d’entreprise. Si le développement de l’industrie à la fin du 19ème siècle correspond à la production de biens nouveaux par un processus nouveau, la révolution agricole, elle, se matérialise à la fin du 20ème siècle par la production de biens identiques, mais par un processus nouveau.
Et cette révolution agricole présente la caractéristique très particulière d’avoir été conduite, non par les individus concernés mais par une superstructure étatique. De ce point vue,nous pouvons dire que c’est bien le pouvoir politique qui fut le fondateur de l’agriculture croissanciste.
Et c’est ce rapport entre l’Etat et l’agriculture que nous allons étudier et détailler dans la prochaine chronique.