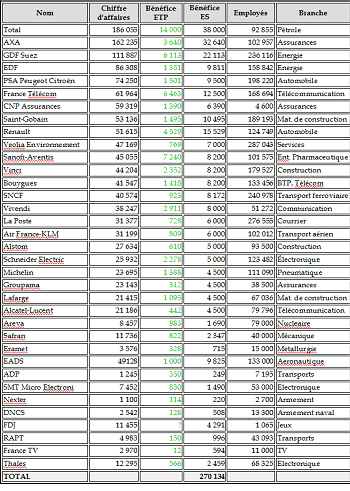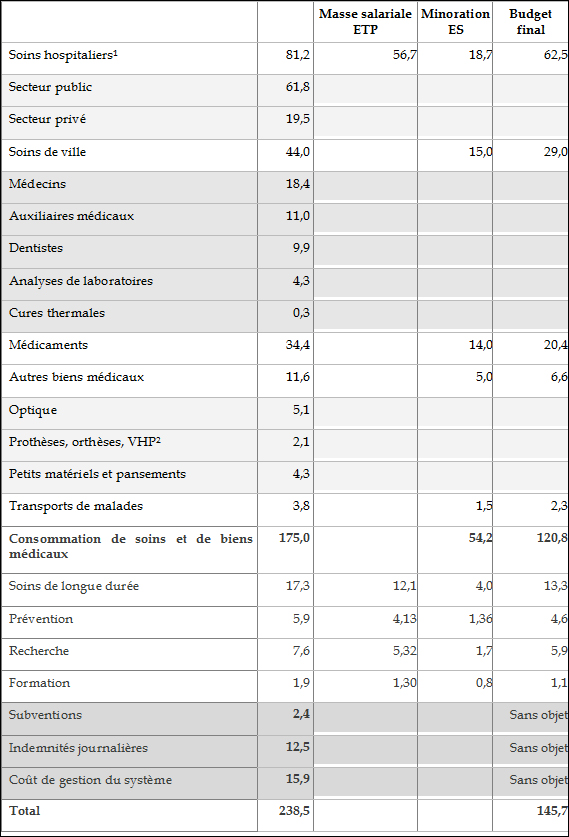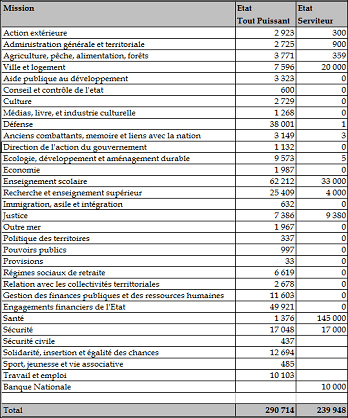Support de débat pour la réunion du 01/01/2023 à 17h00 sur https://meet.jit.si/decroissance
Critique objective de la croissance, par Christian Laurut – Chronique n°16 – Rubrique : L’impasse alimentaire – Sujet : Le pouvoir politique fondateur de l’agriculture croissanciste
Nous avons dit dans la chronique précédente, que la révolution industrielle à la fin du 19ème siècle vise à produire des biens nouveaux par un processus nouveau, à la différence de la révolution agricole qui, elle, se matérialise à la fin du 20ème siècle par la production de biens identiques, mais par un processus nouveau. Ainsi, dans le premier cas, nous sommes bel et bien en présence d’un phénomène d’essence purement individuel, que l’Etat, bien entendu, cherchera rapidement à encadrer et réglementer, alors que dans le second cas, nous assistons à un processus quasiment inversé où c’est l’Etat lui même qui, par l’intermédiaire de son appareil technocratique (pour la mise en forme) et de son bras législatif (pour la mise en place), va imposer et créer les conditions du changement, même si nous devons à la vérité de dire qu’aucune voix ne vint s’élever dans la profession pour contester cette volonté.
Mais ce qu’il faut bien comprendre, c’est que dans cette affaire d’industrialisation de l’agriculture, l’Etat n’a joué qu’un rôle de mandataire du capitalisme qui s’était, en la matière, fixé l’objectif grandiose de transformer un secteur libre, autonome et individualisé en une véritable machine programmable et dédiée aux intérêts de la pétrochimie et de la grande distribution.
Quelque soit le jugement que nous pouvons porter sur la situation actuelle de l’agriculture, il est important de bien avoir à l’esprit que c’est l’Etat, et l’Etat seul, et derrière lui, le capitalisme agro alimentaire, qui détermine toute l’évolution des différentes composantes du secteur, que ce soit les conditions et le niveau de vie des agriculteurs, la qualité des aliments proposés au consommateur, leur traçabilité, leur prix et, d’une façon générale, toute l’information liée au domaine agro-alimentaire.
L’abandon forcé de la polyculture-élevage au profit d’un mode monocultural intensif et productiviste, la soumission de toute une profession aux industriels amonts (fabricants de matériel, d’engrais et d’intrans de synthèse) et aux commerçants avals (grande distribution, import-export) est l’œuvre magistrale et exclusive de l’Etat qui, grâce à un cocktail machiavélique de lois contraignantes et de primes incitatrices, est parvenu à transformer (pour prendre l’exemple de l’Europe) l’exploitant agricole indépendant en un fonctionnaire zélé de la Politique Agricole Commune (PAC).
C’est ainsi que le revenu de l’agriculteur s’est éloigné progressivement de la logique entrepreneuriale pour se rapprocher de la logique salariale, voire du système de l’assistanat social.
Si nous prenons l’exemple français, le niveau moyen de subventionnement de l’agriculture publié annuellement par l’INSEE montre que le soutien au secteur agricole est de 9,7 milliards d’euros (soit 2,5 milliards d’aides directes, 7,2 milliards d’aides découplées chiffres 2009) pour un chiffre d’affaires global de 60,6 milliards (soit 16%).
Nous pouvons également comparer le montant global de ces aides à la valeur ajoutée de l’agriculture (35,0 milliards), soit 27,7% et en conclure que près du tiers du revenu des agriculteurs est constitué d’allocations de l’Etat.
Le métier d’exploitant agricole, qui, avant intrusion de l’Etat capitaliste, consistait simplement à travailler la terre et élever du bétail (labourage et pâturage…) comporte, après intrusion, une activité non subsidiaire consacrée au remplissage de formulaires administratifs et de pointage bancaire des virements du FEAGA, Le Fonds européen agricole de garantie
Ce temps passé, relativement faible en quantité, s’avère néanmoins extrêmement rentable quant aux sommes générées, bénéficiant en tout cas d’un rapport gain/effort totalement hors d’atteinte de celui résultant du temps passé aux champs. Sans compter, que grâce à la petite merveille bureaucratique dénommée « découplage », les aides compensatoires européennes sont, depuis 2006, en effet versées en fonction d’une référence historique (moyenne des aides perçues entre 2000 et 2002), et non plus en fonction d’une production à l’hectare.
Ceci revient à dire que chaque agriculteur touche le même montant quels que soient les végétaux qu’il cultive sur ses parcelles, même s’il les laisse en jachère, et que la terminologie de cette affaire, qui s’est longtemps cherchée dans le maquis des dénominations (aides, primes, allocations, subventions, compensations, soutiens, rétributions, etc..) a enfin trouvé sa voie, en parfaite cohérence avec le système étatique de déresponsabilisation globale de l’individu, celle du « droit à ».
Ainsi, en parfaite conformité avec le procédé magique de la société providence qui métamorphose les devoirs en droits, la mission culturale du paysan a été remplacée par un Droit à Paiement Unique (DPU), venant s’ajouter à la déjà longue liste des droits inaliénables de l’individu industrialisé tels le droit à la santé, à la retraite, au logement, au travail, aux voyages, à la consommation, à la mer, au ciel bleu et au bonheur. En termes clairs, le principe du découplage signifie que l’exploitant agricole a droit à une rente de l’Etat inconditionnelle, et proportionnelle au nombre d’hectares qu’il possède.
Au niveau structurel, l’Etat appose également sa chape de plomb en contrôlant les transactions foncières par l’intermédiaire des SAFER (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) et l’installation des jeunes agriculteurs par le système des DJA (Dotations aux jeunes agriculteurs).
Créées en 1960, les SAFER, par le jeu de leur droit de préemption sur toutes les transactions de propriétés rurales bâties ou non bâties, et de ré-affectation à la tête du client, font la loi sur tout le territoire sous couvert de leur mission d’origine ayant pour objet d’éviter une concentration des exploitations chez les propriétaires les plus fortunés.
En bonnes filles de l’Etat qui avance masqué, ces établissements disposent d’un statut juridique sui generis, découlant de la loi de 1960 et de la jurisprudence afférente, qui les placent à la frontière entre droit public et droit privé.
Ce sont ainsi des sociétés anonymes, à caractère professionnel, placées sous contrôle de l’État, ….. et sans but lucratif (!). En réalité, leur mission consiste à contrôler que les acquisitions rurales soient bien effectuées par des candidats offrant toutes les garanties de mise en œuvre, ou de maintien d’un mode d’exploitation industriel, intensif et productiviste, nous y voilà !
Enfin, cet encadrement drastique est complété par l’octroi de primes d’installation conditionnées par un plan de développement répondant aux critères voulus par l’Etat ainsi que la possession d’un diplôme agricole de niveau IV ne pouvant, comme de bien entendu, être obtenu sans une approbation servile des théories de l’agriculture industrielle par l’étudiant qui le sollicite.
Au delà du jugement sur la validité de l’application forcée d’un modèle étatique sur un secteur d’activité historiquement géré de façon libérale, il importe surtout d’évaluer les résultats objectifs de cette main mise de l’Etat, l’Etat agissant en l’occurrence en tant que VRP de l’oligarchie capitaliste croissanciste rappelons-le, sur la production agricole.
La conséquence la plus aveuglante de cet asservissement, et par voie de conséquence la preuve la plus irréfutable, c’est la dépendance absolue de l’agriculture étatique à la filière capitalistique des hydrocarbures, situation qui serait sans doute toute autre si ce secteur avait gardé son autonomie.
Au contraire de la polyculture élevage qui optimise le cycle naturel, fournit une fumure organique, pratique la rotation des cultures, l’assolement et minimise les besoins de mécanisation, la monoculture industrielle bouscule la nature, utilise des tonnes d’engrais, de fongicides et de pesticides chimiques (fabriqués à partir de gaz et de pétrole), et a recours à des engins toujours plus puissants et gourmands en gas-oil pour remuer une terre toujours plus compacte et plus desséchée.
Cette agriculture fossile, en total contradiction avec les vœux pieux de durabilité régulièrement distillés par la propagande étatique, n’a malheureusement (ou heureusement) aucun avenir tant sur le plan technique que sur le plan stratégique.
Impasse sur le plan technique
Au plan technique, en effet, les méthodes intensives, maintenant généralisées depuis soixante ans sont en train de produire leurs effets dévastateurs sur la terre arable et les taux de fertilité de certains sols sont en train d‘amorcer une régression qui ne peut que préfigurer une fuite en avant fatale qui pourrait se définir de la façon suivante : toujours plus de puissance mécanique, toujours plus d’engrais chimiques, toujours plus de pesticides de synthèse, pour toujours moins de rendement en production alimentaire.
Car, en effet, alors qu’il faudra nourrir 9 milliards de personnes en 2050, voici qu’après des décennies de croissance continue, les rendements du blé, du riz et du maïs s’essoufflent. Pis : ces trois piliers de l’alimentation mondiale déclinent dans certaines régions, faisant craindre une crise majeure.
Des études montrent que depuis le début du 21ème millénaire, que ce soit pour le maïs (par ex. au Kansas, Etats-Unis), le blé (par ex. en Basse-Normandie, France) ou le riz (par ex. à Hokkaido, au Japon), le nombre de tonnes de céréales produites par hectare se tassent, voire commencent à baisser.
Blé, riz, maïs : ces trois cultures représentent 57 % des calories produites par l’agriculture mondiale. Des calories que l’humanité consomme directement ou via l’alimentation du bétail. Sous formes de grains, de farine, de flocons ou de bouillie, ces céréales sont à la base des pains, des pâtes, du couscous, des galettes…
Au début des années 2000, personne n’y a prêté attention… Les récoltes médiocres avaient été mises sur le compte des aléas ancestraux du métier d’agriculteur.
La France céréalière baignait alors dans l’euphorie de quatre décennies de progrès triomphants ; les rendements du blé, qui végétaient à moins de 2,5 tonnes de grains par hectare dans les années 1950, avaient été portés à la fin des années 1990 à plus de 7 tonnes/hectare ! Une révolution verte construite à grands coups d’engrais chimiques, de pesticides, d’herbicides, d’irrigation, de mécanisation et de nouvelles techniques de sélection des semences.
Seulement voilà… les moissons décevantes ont continué de s’enchaîner. Les statisticiens du ministère de l’Agriculture française ont fini par se pencher sur la question. En 2007, il y avait suffisamment de recul pour affirmer que la série en cours formait un plateau, les rendements du blé commençaient à stagner, affirmait François-Xavier Oury, chercheur à l’Institut national de la recherche agronomique (Inra). A un moment, on a même cru que les performances de cette céréale majeure étaient entrain de chuter, témoigne, encore, Christian Huyghe, directeur scientifique à l’Inra.
Malgré le recours aux moyens les plus modernes, les cultivateurs français parviennent difficilement à rééditer certains rendements records atteints en 1984, relève Philippe Gate, écophysiologiste à Arvalis-Institut du végétal.
Or, dans le monde, 805 millions de personnes souffrent de la faim (1 habitant sur 8, et 1 enfant sur 6). De plus, 2 milliards de personnes sont mal nutries, elles manquent des vitamines et minéraux élémentaires. Au total, la survie de 4,5 milliards de personnes dépend du trio blé, riz, maïs.
Le blé, Cette céréale fondatrice de l’agriculture est donc responsable de la survie de 35% de la population mondiale. Or, elle se trouve aujourd’hui dans une situation alarmante : 37 % des surfaces cultivées affichent une stagnation des rendements. La France, troisième exportateur mondial, voit les performances de son blé plafonner depuis environ 1995, sans aucun signe de redémarrage.
Un constat partagé par de nombreux pays européens (Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Danemark, Suède, Grande-Bretagne), et même l’Ukraine, ce fameux grenier à blé. En Afrique du Nord, où le blé apporte près de 50 % des calories aux populations, les cultures ne progressent plus.
Malgré d’intenses apports en engrais, l’Inde déplore 70 % de ses surfaces en panne. Certaines régions australiennes, comme le Queensland, voient même leurs rendements baisser. Les seuls acteurs majeurs en progression sont la Chine et les Etats-Unis, qui partent de très bas -3 t de rendement moyen dans les grandes plaines contre 7 t pour la France. De bien maigres consolations à l’heure où les experts anticipent une augmentation de 70 % de la demande en blé d’ici à 2050.
Cette panne des rendements est donc bien mondiale
C’est pourquoi, Ces dernières années, l’INRA a multiplié les groupes de réflexion et les séminaires. Devant la persistance du problème, l’organisme public entend monter cette année un vaste programme de recherche.
Pourquoi une telle panne ? Les cultures auraient-elles atteint leurs limites biologiques ? Notre modèle agricole serait-il à bout de souffle ?
Depuis trois ans, chaque nouvelle publication scientifique révèle un peu plus l’ampleur du phénomène : l’essoufflement des rendements du blé a gagné d’autres productions agricoles ; Chine et Inde voient les performances de leurs innombrables rizières plafonner ; tandis que le maïs montre des signes inquiétants en Asie, en Afrique, en Europe et dans une partie de la Corn Belt, aux Etats-Unis.
Blé, riz, maïs : ces trois cultures fournissent près de 60 % des calories consommées par la population mondiale.
Selon Kenneth Cassman, professeur d’agronomie à l’université du Nebraska, » au moins un tiers de ces céréales provient désormais de pays en stagnation ou affichant un ralentissement marqué « .
Selon ces scientifiques reconnus, la sécurité alimentaire de la planète pourrait être menacée dès 2050.
En cause : les modifications génétiques des semences, la résistance accrue aux traitements, le changement dans la rotation des cultures, l’hétérogénéité des grandes surfaces remembrées, le réchauffement climatique, etc
Mais il y a aussi : Impasse sur le plan stratégique
A ce triste tableau, vient s’ajouter une impasse stratégique, liée à la raréfaction prochaine et inéluctable de l’énergie fossile sur laquelle est fondée le modèle industriel de la pétro-agriculture. Car il est un fait indiscutable que la déplétion pétrolière signifiera bientôt :
- disette en carburant pour les tracteurs et les moissonneuses,
- manque d’engrais, de pesticides et de fongicides pour les terres,
- autrement dit l’écroulement du système intensif à haute énergie fossile sans que, pour autant, une autre source soit dores et déjà identifiée comme étant capable de lui succéder.
A ce propos, il nous faut dire un mot des possibilités réelles qu’un autre carburant puisse être substitué au pétrole pour ce qui concerne le machinisme agricole. Car, en effet, les biocarburants, ou agro carburants son souvent cités comme pouvant prendre le relais du pétrole après sa disparition.
Malheureusement, ce rêve doit être écarté. D’une part, il convient de préciser que les biocarburants ne constituent pas une véritable innovation dans la mesure où l’obtention d’alcool à partir de céréales, fruits, racines ou légumes est une technique pratiquée depuis fort longtemps. Dès lors nous pourrions logiquement nous demander pourquoi cette technique n’a pas été généralisée plus tôt alors qu’il eut été aisé de développer des moteurs à alcool obtenu à partir de jus de betterave ou de macérats de blé, au lieu de moteurs fonctionnant à l’essence fossile.
En réalité l’absurdité économique de ce qu’on nomme les biocarburants est flagrante. En effet, l’énormité des surfaces cultivables nécessaire au remplacement des 50 millions de barils de pétrole quotidiennement absorbés par les véhicules et engins roulants et volants du monde entier rendrait naturellement le reliquat de surfaces cultivables insuffisant pour produire l’alimentation nécessaire à la survie de l’espèce.
Cette équation évidente et facilement chiffrable n’est contestée par aucun économiste sérieux et il faut donc raisonnablement aller chercher ailleurs le carburant de l’avenir, et notamment pour le machinisme agricole.
Mais la baisse des rendements n’est pas la seule hypothèque posée sur la production alimentaire, il y a également la diminution inexorable des surfaces cultivables, ou plus exactement de la couche fertile des terres arables, autrement dit l’humus, dont nous avons déjà parlé dans notre chronique n°7 sur l’impasse comptable, intitulée les charges cachées de la société industrielle, en indiquant qu’il conviendrait de prendre en compte d’un point de vue comptable les coûts de régénération de la composante humique des sols arables, (si tant est qu’il resterait possible de la régénérer).
Toujours est-il que, dans un rapport de 650 pages, publié en décembre 2015 à l’occasion de la clôture de l’Année internationale des sols, l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) s’inquiète de l’avenir des surfaces agricoles en constatant qu’un tiers des terres arables de la planète sont plus ou moins menacées de disparaître. « Si rien n’est fait, explique son directeur José Graziano da Silva, c’est la production vivrière et la sécurité alimentaire de l’humanité qui pourraient être compromises. »
Le rapport compile les travaux de plus de 200 scientifiques spécialisés de 60 pays. Leur constat est accablant : entre 25 et 40 milliards de tonnes de l’épiderme de la planète sont emportés chaque année à cause de l’érosion, du tassement, de la perte de nutriments et de biodiversité, de l’acidification, des pollutions, de l’engorgement ou encore de la salinisation.
Epaisse de 30 cm en moyenne, cette couche féconde, l‘humus, est un formidable réacteur biologique qui abrite d’intenses échanges biologiques et physico-chimiques, et rend d’immenses services. Elle fournit les éléments indispensables à la croissance végétale, filtre l’eau, contrôle l’alimentation des nappes souterraines, régule le cycle du carbone et de l’azote et constitue l’habitat de près de 80 % de la biomasse !
« C’est le milieu le plus riche de notre environnement « , résume le microbiologiste Claude Bourguignon, fondateur du Laboratoire d’analyse microbiologique des sols (LAMS). C’est aussi l’un des plus fragiles, constitué au terme d’un processus d’altération et de dégradation extrêmement lente de la roche.
Mais la société industrielle a mis en place dans le domaine agricole, un ensemble de pratiques qui, en moins de 100 ans, ont entrepris de balayer l’essentiel du lent travail que la nature a effectué durant des millions d’années, pour structurer notre terre nourricière.
Rongés par ces mauvaises pratiques, elles-même amplifiées par l’urbanisation et la pression climatique, les sols se dégradent désormais à un rythme supérieur à celui de la pédogenèse, processus par lequel ils se forment « , alerte l’agronome Dominique Arrouays, directeur du GIS Sol, le groupement d’intérêt scientifique qui coordonne le programme d’inventaire de l’état des sols en France. Partout où ces phénomènes gagnent, les équilibres s’effondrent et les sols menacent de disparaître. En Europe, cette dégradation touche déjà 33 millions d’hectares, soit 4 % des terres arables.
L’appauvrissement en matière organique lié à l’abandon de la polyculture-élevage au profit de la monoculture intensive, est une autre menace qui pèse sur la fertilité. Depuis les années 1950, la teneur des sols en nutriments et en humus, l’engrais naturel des plantes, a baissé d’un tiers, selon les observations du GIS Sol. «En retournant profondément les sols, les labours de l’agriculture intensive perturbent la vie souterraine et les échanges biochimiques», souligne Claude Bourguignon.
L’apport massif d’engrais, notamment azotés, amplifie encore le problème en favorisant la salinisation des sols, en amoindrissant la quantité de micro-organismes et en polluant les nappes phréatiques. Epuisées, la plupart des terres perdent leur productivité. À l’échelle mondiale, si les rendements ont augmenté de 3 % entre 1950 et 1984, ils n’ont augmenté que de 1 % jusqu’en 1995 et stagnent ou se réduisent depuis lors, nous venons d’en parler tout à l’heure.
Il y aussi les contaminants toxiques qui, dans les pays les plus développés, sont à la manoeuvre dans des proportions qualifiées par les chercheurs d’« anormales à inquiétantes ». Rien qu’en France, il y aurait 300.000 friches industrielles polluées répandant leurs poisons dans les sols et les nappes phréatiques. « On a par exemple pu mettre en évidence que le lindane, un insecticide interdit depuis 1998, est présent dans tous les sols, y compris là où il n’a pas été épandu », indique Dominique Arrouays. En Chine, le ministère de l’Environnement a reconnu que 19,4 % des terres arables du pays étaient contaminées.
Cette situation d’état d’urgence des sols arables, donc de la capacité alimentaire de la planète, va nécessiter un vaste plan de remise en état biologique.
Mais ce plan pourra-t-il être mis en œuvre dans le cadre d’une société devenue contrainte ? On peut en douter, pour le moins. Quant à la qualité des aliments produits par ces sols en perdition, que nous ingérons quotidiennement, quelle est leur actualité, et surtout leur avenir.
C’est ce que nous étudierons dans la prochaine chronique intitulée : Que mangerons-nous demain ?